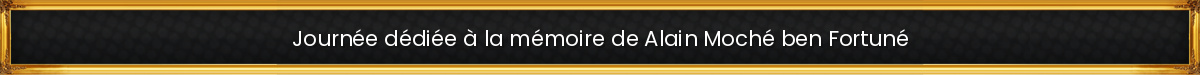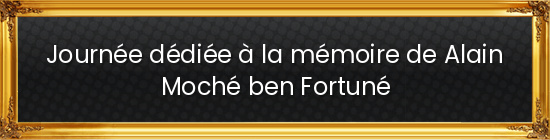La notion de « non-assistance à personne en danger », si galvaudée de nos jours, trouve en réalité sa source dans une mitsva explicite de la Torah : « Ne reste pas indifférent devant le sang de ton frère » (Vayikra 19, 16) – qui nous enjoint de prêter secours à toute personne en difficulté.
Pour l’anecdote, la notion juridique de « non-assistance à personne en danger » a été entérinée en France par le régime de Vichy, sous l’Occupation, pour réprimer la nonchalance de la population française envers les troupes allemandes « victimes » des attentats de la Résistance. C’est dire si la justice est aveugle…
Pour revenir à notre verset, il énonce bien, dans son sens textuel, l’interdiction d’assister passifs à la détresse de notre prochain en péril, alors que nous aurions les moyens de lui venir en aide. Mais en réalité, cette mitsva s’étend à de nombreuses autres circonstances où un individu est en mesure d’apporter assistance à son prochain et ne le ferait pas.
En témoigne cette décision du Rambam (Hilkhot Rotséa’h 1,14, citée par le Choul’han Aroukh ‘Hochen Michpat 426) :
« Celui qui verrait son prochain se noyer, qui le verrait être attaqué par des brigands ou par une bête sauvage et qui aurait les moyens de lui porter secours (…) ou encore, si l’on devait avoir surpris des non-Juifs ou des délateurs comploter contre lui et chercher à lui tendre un piège et que l’on refuse de lui révéler l’information (…) on se rend coupable de ‘rester indifférent devant le sang de notre frère’ ».
En outre, ce n’est donc pas seulement pour le sauvetage de vies que nous avons le devoir d’intervenir, mais également lorsqu’il s’agit d’épargner autrui d’une perte financière ou de toute forme de préjudice. Le Sifra le révèle explicitement : « D’où savons-nous que lorsqu’un homme détient un témoignage au bénéfice d’autrui, qu’il n’a pas le droit de se taire ? Du verset : ‘Ne reste pas indifférent devant le sang de ton frère’… » (Sifra paracha 2, 8).
Visiblement, cette mitsva pourrait se résumer à une forme de responsabilité sociale, selon laquelle chacun doit – dans la mesure de ses moyens – porter assistance à autrui pour harmoniser la vie au sein de la société. De fait, telle est la conclusion à laquelle aboutit le Séfer ha’Hinoukh (mitsva 237) : « De la même manière que l’un sauve son prochain des dangers qui le guette, ainsi lui-même sera sauvé par autrui et l’humanité se verra ainsi préservée ».
Mais à la lumière de quelques réflexions soulevées par les décisionnaires sur ce thème, le sens de cette mitsva pourra nous apparaître sous un nouvel angle.
Droit à la mort volontaire
Une question-clé que l’on découvre à ce sujet – et qui n’a rien perdu de son actualité – est celle de l’assistance face à une personne réclamant le droit de disposer à son gré de la mort. Si la Torah nous enjoint de porter secours à toute personne en danger, cela inclut-il aussi celle qui refuserait ce secours, et qui ne demanderait qu’à ce qu’on laisse sa vie s’éteindre ? La Torah nous impose-t-elle de sauver une vie contre son gré ?
La réponse n’est pas aussi simple qu’elle pourrait sembler l’être : si bon nombre d’auteurs imposent le sauvetage du candidat au suicide en dépit de sa volonté, certains ne le considèrent toutefois pas comme étant obligatoire…
Nous voyons en effet que le Talmud (Sanhédrin 73/a) assimile le thème de « l’assistance à personne en danger » à celui de la restitution d’objets perdus : de la même manière que nous avons l’obligation de restituer un bien perdu, ainsi devons-nous « rendre » à autrui la perte de son corps – c'est-à-dire lui porter secours face à un danger, comme le suggère l’accentuation prononcée du verset : « Tu le lui restitueras » (Dévarim 22, 2).
Or, note le Min’hat ‘Hinoukh (mitsva 237), il existe une règle relative aux objets perdus selon laquelle nous n’avons pas l’obligation de restituer un bien perdu sciemment et en connaissance de cause ! Par conséquent, enchaîne cet auteur, il en irait de même pour la « perte du corps », pour laquelle nous ne serions pas tenus d’intervenir si elle devait survenir volontairement, autrement dit dans un cas de suicide.
Evidemment, ce rapprochement entre « objets perdus » et « corps en péril » n’est pas à prendre au pied de la lettre : pour cet auteur, il signifie plutôt que l’homme dispose de lui-même de la même manière qu’il dispose de ses biens. Si le suicide est de toute évidence proscrit par la Torah – notamment en vertu du verset : « Je demanderai compte du sang qui fait votre vie » (Béréchit 9, 5) – chacun est néanmoins l’unique décideur du sort qu’il réserve à sa vie. Et de même qu’une personne peut, à son gré, dilapider sa fortune – bien que rien ne l’y autorise –, il peut tout autant décider de mettre un terme à ses jours sans que quiconque ne puisse l’en empêcher.
Contrat de mariage…
Si peu de décisionnaires abordent cet aspect de la mitsva, nombre d’entre eux semblent cependant s’opposer à la décision du Min’hat ‘Hinoukh (cf. dans les annotations du Makhon Yérouchalaïm sur place). Ainsi, le Rivach – Rabbi Its’hak Bar Chechat (1326-1408) –, sans évoquer le problème explicitement, suggère néanmoins dans l’un de ses responsa (484) une claire opposition à ce point de vue. La question dont traite ce maître est celle d’un prêt dont une clause explicitait qu’en cas de non remboursement, le créancier serait en mesure de saisir son dû à partir du corps même de l’emprunteur, impliquant sujétion et asservissement corporelles jusqu’à hauteur de la dette.
Dans sa réponse, le Rivach soutient que de telles conditions ne peuvent être reconnues ni approuvées par un Bet-Din, dussent-elles être stipulées explicitement dans l’acte de prêt. Pour preuve, écrit-il, le Talmud évoque à plusieurs reprises (notamment dans kiddouchin 19/b) une discussion concernant un acte de mariage – des kiddouchin – lors duquel le marié spécifierait qu’il ne s’engage à aucun de ses devoirs conjugaux. Or dans cette situation, Rabbi Yéhouda stipule que toute condition ayant trait à des questions pécuniaires – telle que l’obligation de nourrir et de vêtir l’épouse – pourra être maintenue. En revanche, les conditions relatives aux devoirs corporels de l’homme vis-à-vis de sa femme seront déclarées nulles et non avenues, dans la mesure où un renoncement à des droits corporels est sans effet.
En résumé, le Rivach insiste sur le fait que nul n’est en mesure de s’infliger des dommages corporels, ou même d’assujettir son corps à autrui de quelque manière que ce soit : « Qu’un homme s’engage à accepter des souffrances corporels – autorisant par là le Bet Din à l’y contraindre –, une telle chose n’est pas cautionnée par la Torah ». Et par déduction, nous pouvons en conclure que nul ne peut exiger qu’on le laisse librement mourir, dans la mesure où une telle décision ne lui appartient pas…
Vœu de chasteté
Or de prime abord, la preuve citée par le Rivach mérite des éclaircissements supplémentaires : le Talmud dit ici qu’un homme ne peut imposer à sa future épouse de renoncer à ses droits conjugaux, et ce bien qu’elle y consente explicitement. Pourtant, un principe clairement énoncé dans la Torah semble s’opposer à cette décision : la notion des vœux et serments, par laquelle tout homme peut s’astreindre à quelque exigence que ce soit – corporelle ou non – sans que la moindre restriction n’existe à ce sujet. Et si certes, la Torah considère la formulation d’un vœu comme une forme de « faute », elle n’en demeure pas moins valide et reconnue.
Il convient donc de comprendre : si une femme peut renoncer de son gré à tout privilège qui lui revient de droit, pourquoi ne pourrait-elle consentir à ce que son mari s’en dispense lui-même ? Autrement dit, il semblerait qu’une personne puisse elle-même s’astreindre à ce que bon lui semble, mais il lui est interdit d’admettre qu’autrui en soit l’instigateur… Ce paradoxe réclame évidemment quelques éclaircissements.
L’indifférence
La réponse se trouve peut-être dans les termes même de notre verset : « Ne te tiens pas indifférent devant le sang de ton frère ». Certes, indépendamment du fait que la Torah s’y oppose, tout homme peut faire ce que bon lui semble de son sang et de sa chair. Mais au demeurant, notre devoir moral n’en est pas moins d’intervenir en toute circonstance, et de ne pas assister à sa perte en toute indifférence. Si lui décide de s’infliger la mort ou les tortures, nous-mêmes ne pouvons être les témoins impassibles de sa détresse… Car le droit dont dispose quelqu’un sur lui-même, ne dispense en aucune manière les autres de leur responsabilité à son égard.
De ce fait, même si une femme est en mesure de s’infliger des privations ou des souffrances – parce que tel est le privilège que la Torah lui offre au moyen des vœux –, son mari ne peut, lui, l’y astreindre. Parce que prononcer des clauses contraignantes au moment du mariage revient, pour le mari, à infliger à sa femme une vie de souffrance qu’elle ne mérite pas de connaître. Et c’est son devoir moral à lui qui lui interdit d’agir de la sorte.
Il en va de même pour l’assistance à personne en danger. Si ce devoir se résumait à une « commodité sociale » – permettant à chacun de s’en remettre au soutien des autres face à toute difficulté –, rien ne justifierait que l’on doive sauver une personne renonçant sciemment à la vie. Si ce devoir s’impose malgré tout, c’est bien parce qu’une autre dimension se cache derrière ce commandement, dimension mise en lumière par la comparaison avec le mariage soumis à condition.
Sauver autrui d’un péril indépendamment de sa propre volonté, relève en effet d’un devoir moral personnel, qui nous défend d’assister en toute indifférence à la détresse d’autrui, dut-il l’avoir lui-même commandée. Car le mal existe aussi sous une forme absolue, et nul n’est à même de décréter qu’un mal tel que la mort représente pour lui un bien.