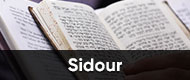Les années 70 ont connu un réveil surprenant du judaïsme chez des personnes éloignées, particulièrement parmi la jeunesse. Chronologiquement, nous nous trouvons dans une période marquée par de grands bouleversements dans la société occidentale, à la suite des nouvelles conceptions qui ont émergé à cette époque. On ne veut plus de guerre, on prône la liberté dans tous les domaines, on repense la famille, la femme s’émancipe, les rapports entre enfants et parents sont bouleversés, on conteste le pouvoir ; on aspire, en fin de compte, à un autre monde, plus pacifique, dans lequel on pourra rêver et dont l’avenir apparaîtra rassurant. Les artistes participent à tous ces changements et en deviennent même les meneurs.
Pourtant, face à la réalité, des brèches apparaissent dans tous ces mouvements. Les Juifs qui y ont pris part perçoivent très vite l’impasse vers laquelle ils se dirigent et cherchent déjà à rebondir vers d’autres voies. C’est dans ce contexte qu’apparaissent les premières lueurs de la Téchouva moderne, qui va se développer de plus en plus.
Le Rav Nota Schiller, décédé récemment, réalise alors qu’il est primordial de créer une structure pour cette jeunesse errante en quête de sens. Pur produit des grandes Yéchivot des États-Unis et d’Israël, il envisage alors d’ouvrir une Yéchiva adaptée aux Ba’alé Téchouva anglophones. Il est conscient qu’il est impensable de calquer le modèle dans lequel il a été formé. En effet, comment enseigner toute la journée des passages du Talmud (sujet principal d’étude dans une Yéchiva) à des jeunes qui ne savent même pas qui sont Avraham ou Moché ? Comment instituer trois prières par jour pour des personnes qui, parfois, ne savent même pas lire l’hébreu ? Leur connaissance de la loi étant négligeable – pour certains, ils vivent leur premier contact avec le Chabbath –, comment leur faire découvrir le Choul’han ‘Aroukh sans les rebuter ?
Mais le Rav y croit et, avec patience et doigté, il saura mettre sur pied un programme d’étude correspondant au niveau de ces jeunes. Il réalise que, s’il est essentiel de répondre à leurs questions existentielles et de les éclairer sur l’apport du judaïsme, l’étude du Talmud possède cette qualité unique de “transformer” l’étudiant. Le Chabbath, il invitera régulièrement des élèves chez lui afin de leur faire découvrir la beauté de ce jour saint. L’atmosphère de liberté qui règne dans la Yéchiva et propice à la construction personnelle, ainsi que la présence d’une équipe de Rabbanim dévoués, faciliteront l’intégration de ces jeunes et leur épanouissement. Les résultats ne se feront pas attendre, et la véritable révolution commence : des milliers d’étudiants en feront l’expérience, s’approchant doucement mais sûrement de la pratique et fondant plus tard leur foyer dans le berceau du judaïsme.
La Yéchiva Or Saméa’h du Rav Schiller – dont un département francophone verra le jour – servira de modèle à de nombreuses autres Yéchivot pour Ba’alé Téchouva. Ce Rav visionnaire aura eu le mérite d’avoir ouvert la porte à d’autres initiatives bénéfiques, qui ont permis à ce mouvement de retour de la fin des temps de prendre son essor. Son secret ? Il était convaincu que la Torah, dans son essence, s’adresse à tous, quel que soit leur passé ; le seul enjeu est de trouver l’approche adéquate pour la diffuser. Son innovation ne touche, en fin de compte, que la forme, sans dévier d’un millimètre de la pure Tradition.
L’action du Rav Nota Schiller s’inscrit dans la lignée de toutes celles que le peuple hébreu a entreprises tout au long de l’Histoire pour diffuser la Torah, un engagement nécessitant abnégation et courage, mais aussi créativité, une qualité indispensable. Torah-Box n’en est-il pas aussi l’expression ?